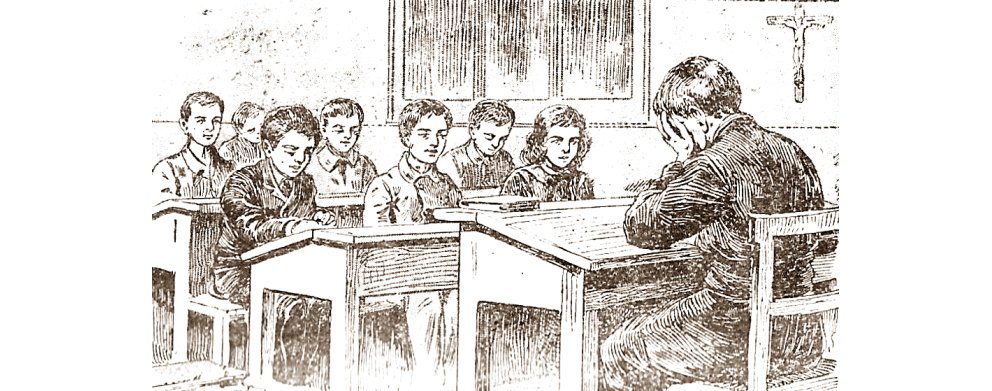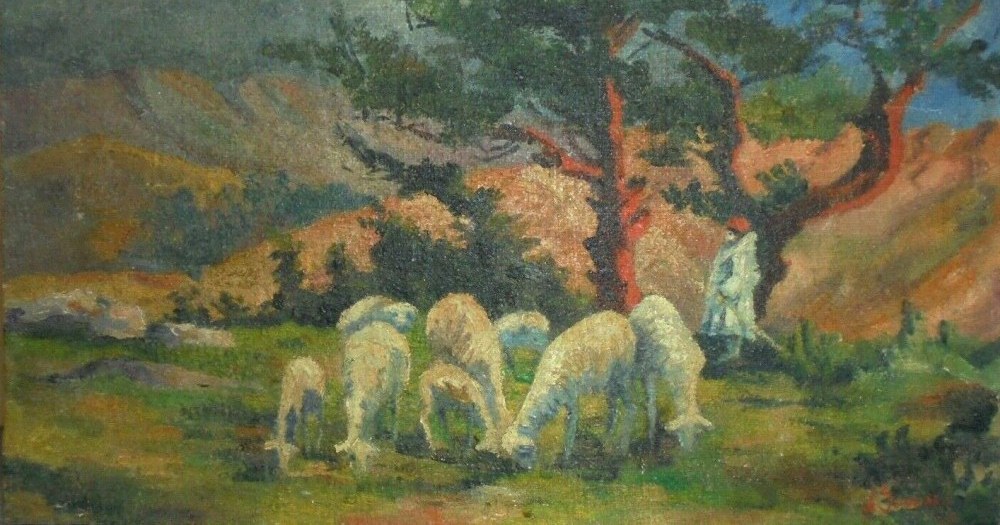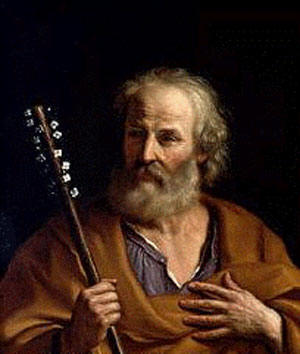Le Père Middlelon, au catéchisme, avait parlé avec douceur et insistance de la miséricorde de Dieu. 1l avait tout d’abord dit quelques mots sur la nécessité de la contrition puis il avait posé des questions aux élèves afin de s’assure qu’ils avaient bien compris sa pensée.
« Harry Quip, commença-t-il, répondez-moi. Supposez mon ami, que vous êtes un grand pécheur : depuis que vous avez l’âge de raison, vous avez commis péché mortel sur péché mortel. Toutes vos fautes souillent encore votre âme, toutes vos confessions ont été mauvaises, et vous apprenez subitement que vous allez mourir, ici même, dans cette classe. Faut-il désespérer ?
— Non, Père, répondit Harry. Je demanderais à la Saint Vierge, notre Mère bénie, de m’obtenir la grâce de faire un bon acte de contrition, et je me confesserais, m’abandonnant dans les bras de la miséricorde de Dieu.

— Mais voici, Carmody, continua le professeur, vous n’avez jamais fait une seule bonne action, et d’un autre côté, vous avez sur la conscience tous les péchés que tous les enfants du monde ont commis. Que feriez-vous dans ce cas, si l’on vous disait qu’il faut mourir de suite ?
— Je me confierais dans les mérites infinis du Précieux Sang.
— Joseph, voici un cas plus grave : votre conscience est salie de tous les péchés dont j’ai parlé, et vous êtes seul, sans compagnons, livré à vos faibles forces, au milieu de, l’océan ; aucun prêtre près de vous pour vous absoudre, aucun ami pour prier pour vous. Que faire ?
Joseph répondit avec une élévation suggérée sans le vouloir par les paroles mêmes de son professeur :
— J’essaierais avec la grâce de Dieu de faire un acte de contrition parfaite ; alors, je m’enfoncerais dans les vagues comme dans les bras de Dieu : Dieu est partout !
— Voilà une belle réponse. Mais, Reynolds, supposez que Dieu, en punition de tous vos péchés, vous afflige d’une hideuse maladie. Supposez alors que vos amis s’éloignent de vous avec horreur, que vos relations vous rejettent parmi les bêtes ; supposez que vous êtes mourant de dénuement et de faim, et, au moment de votre mort, vous demandez un prêtre pour entendre votre confession, mais celui-ci, épouvanté par votre état repoussant, s’enfuit au loin, criant que Dieu vous a déjà damné ! Seriez-vous désespéré