.
Temps de lecture : 15 minutesChapitre XIII
Joies et épreuves se suivent vite dans la vie.
Les collégiens étaient à peine rentrés, la pensée encore toute occupée du mariage de Jeannette, qu’une nouvelle très inquiétante leur parvenait.
A quelques semaines de son ordination, au séminaire de Rome, Yvon était gravement malade. Tout faisait craindre une fièvre typhoïde extrêmement violente.
Colette est consternée.
— Si Yvon allait mourir avant d’être prêtre ? dit-elle à M. le curé, qu’on est allé trouver bien vite, avec maman, pour lui demander des prières.
— Allons, allons ! ne mettons pas tout au pire ! Une fièvre typhoïde, ça se soigne, voyons ! La grosse peine de cet enfant, c’est de voir retarder son ordination. Mais aussi, l’heure venue, il sera d’autant plus heureux qu’il l’aura payée plus cher,… le Bon Dieu a ses vues, voyez-vous ! Faisons-lui confiance, et tout ira bien. Je dirai ma messe demain pour notre pauvre malade. Et puis, je vais mettre les enfants de l’école en prière. Vous verrez que nous serons exaucés. Tenez-moi bien au courant, surtout !
En rentrant à la maison, Colette confie à sa mère :
— M. le curé est un vrai saint. Je crois qu’il va obtenir du Bon Dieu tout ce qu’il voudra.
Colette ne croyait pas si bien dire, car, après de véritables angoisses, Yvon ayant été mourant, on apprit enfin par tante Jeanne, qui l’avait immédiatement rejoint à Rome, que la convalescence commençait. Le docteur ordonnait de transporter le malade à la campagne, dès qu’il pourrait supporter le voyage, et, bien entendu, c’est dans l’hospitalière maison familiale qu’on l’attend.
On devine le branle-bas. Pierrot déniche au grenier une antique chaise-longue ; Colette crève de vieux oreillers pour les transformer en coussins. La plume vole un peu partout, et Marianick pousse des soupirs à gonfler une voile de bateau ; mais, après tout, c’est pour Yvon !
Pauvre Yvon ! Quand il débarque, diaphane et maigre comme un échalas, ses cousins ont bien de la peine à cacher leur surprise. Et puis, on le sent si triste. Cette ordination remise, et à quand ?
Mais Yvon comptait sans son bon curé.
Un beau matin, le vieux prêtre paraît à la grille du jardin. Il a marché si vite qu’il doit s’éponger le front avec l’immense mouchoir à carreaux qui fait le bonheur des enfants. Ses yeux gris, demeurés si clairs malgré les années, pétillent derrière les lunettes et cherchent du regard la fameuse chaise-longue sur laquelle Yvon demeure étendu dehors, toujours excessivement faible, silencieux et déprimé, car il lui semble qu’il ne se remet pas assez vite.
L’ayant découvert, le bon curé se hâte, un sourire heureux épanouissant sa physionomie.
Yvon le salue d’un geste las.
— C’est comme ça que tu m’accueilles ? Tu ressembles à un saule pleureur couché par la tempête.
— Je ne reprends aucune force, monsieur le Curé, et puis, croyez-vous que je sois bien gai ?
— Fichtre non ! tu n’es pas gai. Ça se voit à cent mètres de distance, et c’est justement ça que je te reproche. Comment prêcheras-tu aux autres le courage et l’abandon, quand tu seras prêtre, si c’est tout ce que tu en possèdes ? On ne donne que ce qu’on a, je ne te l’apprends pas, pourtant.
— Quand je serai prêtre… Mais c’est cette ordination manquée qui me tourmente, … vous le savez aussi bien que moi, monsieur le Curé.
— Homme de peu de foi ! Si tu n’avais pas été si gravement malade, je te semoncerais d’importance. Écoute-moi donc un peu et prends une autre tête. J’étais hier à l’évêché. Il n’y a pas qu’à toi qu’il arrive de gros soucis. Monseigneur a deux séminaristes dans ton cas, l’un dans une clinique, l’autre avec un grave accident à la jambe. Ils manqueront tous les deux l’ordination de la Saint-Pierre, et alors…
 « Il faut envoyer cet enfant à la campagne. Mettez-le petit berger dans une bonne famille de cultivateurs, vous verrez comme cela lui fera du bien ; l’âme et le corps y gagneront.
« Il faut envoyer cet enfant à la campagne. Mettez-le petit berger dans une bonne famille de cultivateurs, vous verrez comme cela lui fera du bien ; l’âme et le corps y gagneront.
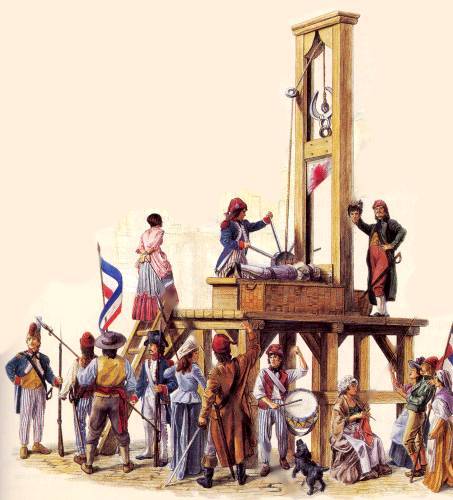
 Pourtant, elle n’a pas rêve. On a heurté sa porte. Et qui peut venir à cette heure de la nuit ?… Elle frissonne : nul ne se sent en sécurité sous cette «
Pourtant, elle n’a pas rêve. On a heurté sa porte. Et qui peut venir à cette heure de la nuit ?… Elle frissonne : nul ne se sent en sécurité sous cette « 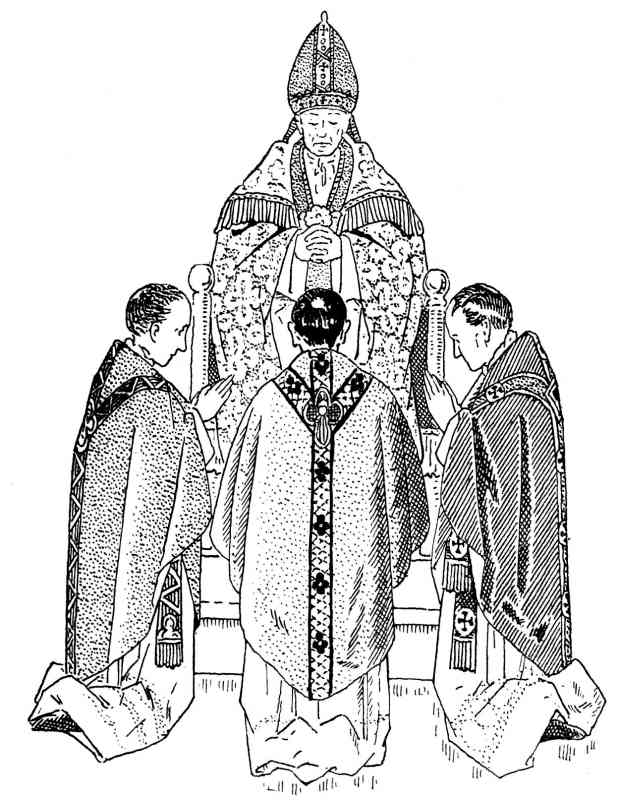

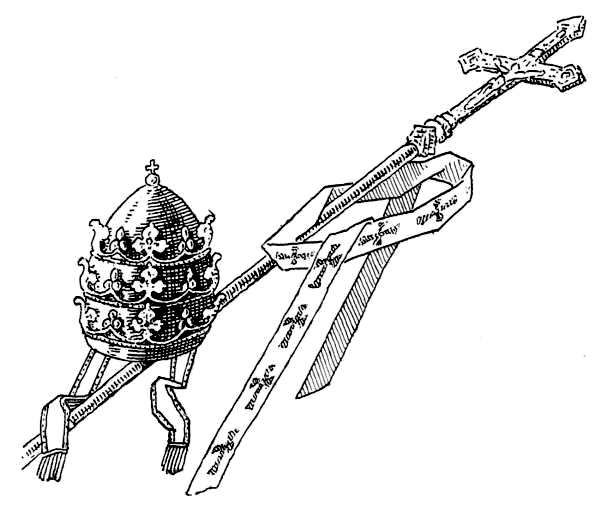

 L’antilope parut comprendre ce geste de bonté. Elle se traîna jusqu’au pied de l’arbre et s’y coucha pour attendre la pluie… ou la mort.
L’antilope parut comprendre ce geste de bonté. Elle se traîna jusqu’au pied de l’arbre et s’y coucha pour attendre la pluie… ou la mort.