Le jour de sa vêture, elle avait reçu le nom de Sœur Saint-Joseph. Avec les années, elle s’était tellement ratatinée qu’on ne l’appelait plus que la « petite Sœur » ! Le nom de son grand Patron s’était évanoui ! Non pas qu’il fût trop long à prononcer, mais parce que l’ex-pression de « petite Sœur » suffisait largement à la désigner. Et puis saint Joseph a l’habitude de s’éclipser, quand il a rempli son rôle, et de laisser seulement dans les âmes l’amour de la vie cachée.
Toute menue dans son ample habit aux plis innombrables, la tête emprisonnée dans un voile blanc qui encadrait son fin visage, la « petite Sœur » était la providence des marmots, dans un village d’Auvergne où ses supérieures l’avaient envoyée.

Dès l’âge de cinq à six ans, les enfants se dirigeaient à petits pas vers le vieux couvent où la petite Sœur les accueillait d’un sourire. Ce sourire était leur coqueluche ! Les tout-petits le regardaient béatement, comme si c’était un sourire de paradis qu’ils se souvenaient d’avoir vu dans leurs premiers rêves. Ils souriaient, eux-aussi, prêts à toutes les sagesses, pour que le sourire de la petite Sœur restât longtemps en place.
On ne voyait pas les oreilles de la petite Sœur. C’était le seul mystère qui rendît perplexes les admirateurs du sourire. L’un d’eux se hasarda un jour à poser tout haut la question qui les hantait tous.
— Mes oreilles ? Elles sont là ! dit la petite Sœur en dégageant son voile. Et elles sont bonnes !
— Et pourquoi que vous les cachez ? Nous, on les a bien dehors !
— Ah ! Mes enfants, je les cache pour qu’elles restent bien petites et qu’elles n’entendent que les choses qui en valent la peine… Vous comprendrez plus tard. Allons ! Venez autour de moi, vous allez lire.
Et les têtes blondes ou brunes se courbaient tout autour de la petite Sœur, dont les genoux supportaient le livre aux grandes lettres noires.
Depuis longtemps, la petite Sœur caressait un rêve, un rêve si beau qu’elle s’étonnait elle-même de l’avoir, et qui la suivait partout ; à la messe, au réfectoire ; mais c’était surtout en classe qu’il la tracassait, quand son regard errait sur les têtes blondes ou brunes, comme un souffle léger qui passe sur des épis mûrissants. Elle songeait alors à la moisson qui lève au soleil. Et la moisson lui suggérait l’idée du moissonneur qui se penche sur les épis et rentre le soir, joyeux, en portant les lourdes gerbes. Ce spectacle lui rappelait, à son tour, la parole de Jésus : « La moisson est abondante ; les ouvriers sont peu nombreux ; priez le maître de la moisson qu’il envoie des ouvriers à son champ. »
Et le rêve de la petite Sœur prenait corps. Elle en devenait toute rougissante. Elle en perdait même le fil de la lecture.
Son rêve ! C’était que l’un de ces enfants auxquels elle apprenait à lire devînt prêtre et qu’elle y fût pour quelque chose.
— Tu t’es trompé, Pierre. C’est B‑A, BA qu’il faut lire ; alors ! recommence, mon petit.
Et les bambins s’étonnaient de sa voix si douce, alors qu’une juste impatience pointait d’ordinaire dans ses paroles, aux erreurs de lecteur. Et ils levaient les yeux sur la petite Sœur, car ils savaient que c’était dans ces moments-là que le plus délicieux sourire animait son visage.

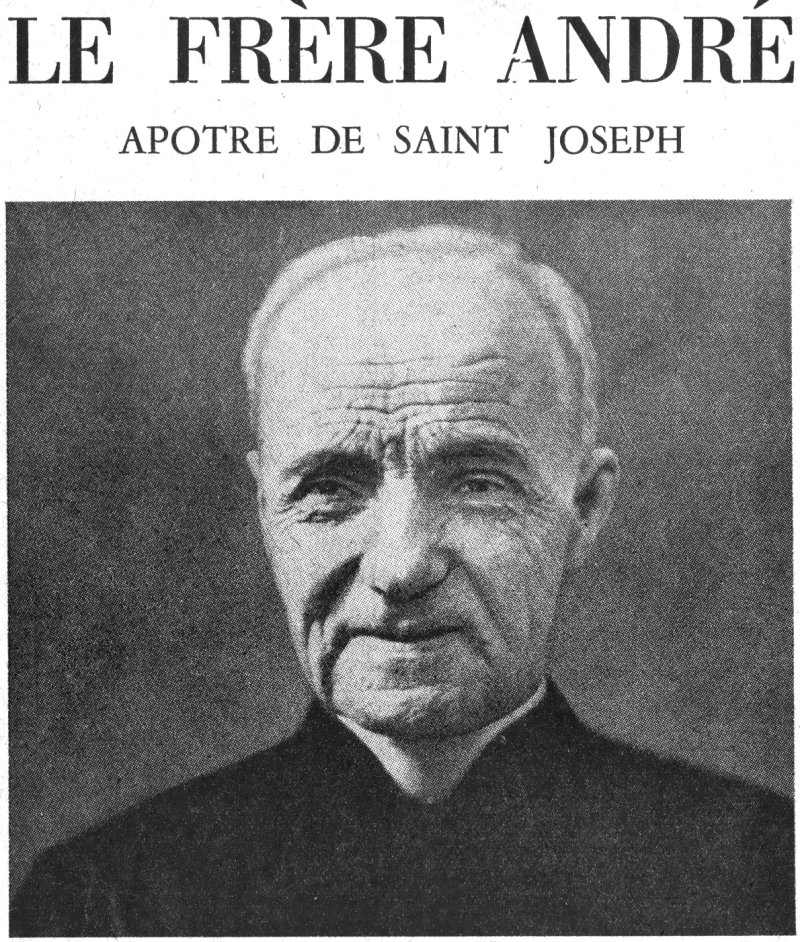
 Messire Provençal, curé de Saint-Césaire, au
Messire Provençal, curé de Saint-Césaire, au 
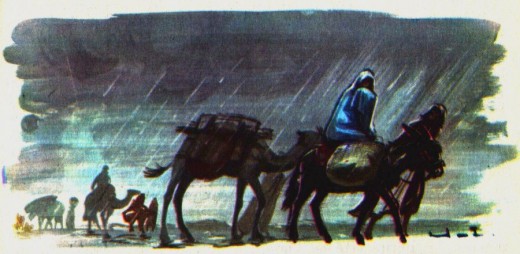
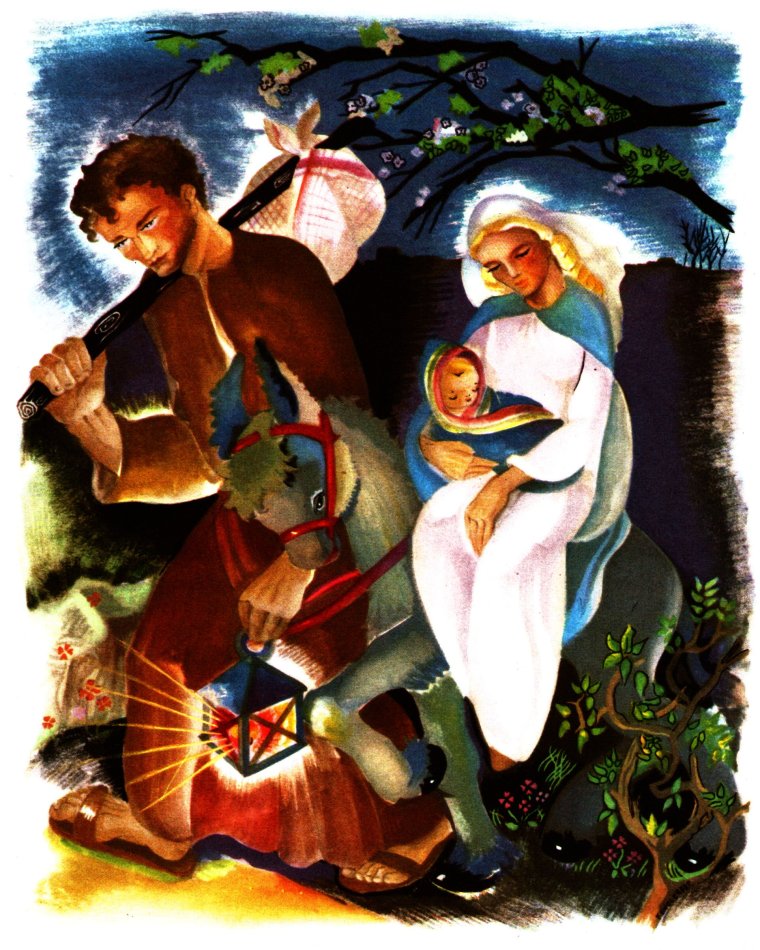

 ANT bien que mal, la
ANT bien que mal, la 



 Aussitôt, de derrière les arbres, sortirent de petits anges. C’étaient de jeunes enfants, roses et joufflus ; ils avaient sur le dos des ailerons qui leur permettaient de voleter quand ils voulaient, et qui, le reste du temps, rendaient leur marche facile et légère. Ils étaient adroits et plus vigoureux que ne le faisaient supposer leur âge tendre et leur petite taille.
Aussitôt, de derrière les arbres, sortirent de petits anges. C’étaient de jeunes enfants, roses et joufflus ; ils avaient sur le dos des ailerons qui leur permettaient de voleter quand ils voulaient, et qui, le reste du temps, rendaient leur marche facile et légère. Ils étaient adroits et plus vigoureux que ne le faisaient supposer leur âge tendre et leur petite taille.