Barsabas ou le don des langues
II
LE CITOYEN DU MONDE
Quiesce a nimio sciendi desiderio,
quia magna ibi invenitur distractio
et deceptio !
(Imitatio Christi, I, s.)
Devant la grâce inattendue qui venait de lui échoir, Barsabas se sentit d’abord si heureux à la fois et si effrayé que, bien qu’il pût maintenant répondre sans effort aux questions de ses amis, il ne prit pas même le temps de les écouter. Rentré dans sa chambre, il se hâta d’en faire sortir un petit garçon avec qui tous les soirs il avait coutume de jouer, et qui, ce soir-là encore, voulait, à toute force, lui grimper sur le dos. Puis, ayant verrouillé la porte pour n’être plus dérangé, il se prosterna et pria humblement Seigneur, s’écria-t-il, vous m’avez honoré par delà mon mérite ! Au dernier de vos serviteurs vous avez daigné confier le plus précieux de vos dons ! Et voici cependant, – telle est ma faiblesse ! – voici que je tremble de frayeur à la pensée des devoirs nouveaux qui en résultent pour moi : « Soutenez-moi, Seigneur, éclairez-moi, dites-moi ce que je dois faire, afin que je ne sois qu’un outil entre vos mains, l’instrument de votre gloire et de votre justice ! » Mais le Seigneur ne lui dit rien, et Barsabas se vit contraint de décider lui-même ce qu’il devait faire.
Aussi bien ne pouvait-il guère hésiter sur le premier et le plus urgent des devoirs nouveaux qui s’imposaient à lui ; et sa frayeur ne lui venait, précisément, que de sa trop claire conscience de ce pénible devoir. Il avait, en effet, tout de suite compris que le don des langues ne lui avait pas été accordé simplement pour qu’il pût s’entretenir, à Jérusalem, avec des étrangers déjà convertis, ni moins encore pour qu’il s’en retournât mener sa vie silencieuse à l’ombre des collines de son cher village. Le don des langues lui imposait le devoir de parcourir le monde, pour porter aux païens la sainte parole : cela était certain, hélas ! trop certain !
Tout au plus eut-il un instant l’idée que, si son maître avait vraiment exigé de lui un pareil sacrifice, c’est lui qu’il aurait désigné pour faire partie des douze apôtres, au lieu de Mathias. Mais aussitôt il rougit de cette idée, misérable prétexte suggéré par sa lâcheté. Le pouvoir miraculeux de parler toutes les langues n’était-il pas un signe d’apostolat aussi évident, pour le moins, qu’une élection où peut-être le hasard avait seul agi ? Non, non, Barsabas sentait que nul doute ne lui était possible ! Et plus était cruel le sacrifice que son maître exigeait de lui, plus il se sentait tenu de l’accomplir, en échange de l’immense faveur qu’il avait reçue. Il résolut donc de quitter Jérusalem dès le lendemain, et de se mettre en route vers les pays étrangers, après avoir dit un rapide adieu à sa femme, à sa mère, aux lieux qui, jusqu’alors, avaient été pour lui l’univers entier.
Encore ne leur dit-il cet adieu que par procuration. Ayant rencontré, aux portes de Jérusalem, un paysan de son village qui rentrait chez lui, c’est sur lui qu’il se déchargea du soin d’annoncer aux siens sa nouvelle mission.
« Je comptais aller moi-même prendre congé d’eux, ajouta-t-il, mais le ciel a eu pitié de moi, et voici qu’il t’a envoyé sur mes pas, pour m’épargner un supplice au-dessus de mes forces. Ou plutôt ce sont les dangers de la tentation que le ciel, sans doute, aura voulu m’épargner : car je me demandais comment, après avoir revu tout ce qui m’est cher, je trouverais le courage de m’en séparer. Adieu donc, frère bien-aimé ! Et quand, après-demain, du haut de la colline, tu apercevras à tes pieds les maisons de notre village, rappelle-toi ton frère Barsabas qui s’en va, seul et triste, parmi des inconnus ! »
Barsabas pleurait en disant ces mots ; puis il se jeta, tout pleurant, au cou de son ami. Mais à peine l’eut-il vu disparaître, dans la poussière du chemin, qu’il ne put s’empêcher de songer qu’il avait été, lui aussi, la veille encore, semblable à ce paysan inutile et grossier. Et, fiévreusement, il eut soif d’employer au plus vite, pour le bien de son maître, le magnifique don qu’il portait en lui. Quand son ami, le surlendemain soir, aperçut du haut de la colline les maisons du village, il soupira en se rappelant le pauvre Barsabas qui allait, seul et triste, sur des routes lointaines ; mais Barsabas, au même instant, marchait d’un pas alerte et la tête haute, méditant le discours qu’il prononcerait dès qu’il rencontrerait une ville, devant lui.
Cette ville se trouva être Péluse, dans la Basse-Égypte ; et Barsabas, qui y était parvenu après cinq jours de marche, fut d’abord tenté de marcher cinq jours de plus pour s’en éloigner. Habitué comme il l’était aux mœurs rustiques de la Galilée, Jérusalem déjà lui avait paru inhabitable ; mais il se sentait prêt maintenant à la regretter, en comparaison de cette ville étrangère où, depuis les traits des visages jusqu’à la façon de manger et de se vêtir, rien ne ressemblait à ce qu’il connaissait. La largeur des rues, la hauteur des maisons, les amples manteaux et les lourds souliers, tout cela était, à ses yeux, aussi laid qu’incommode. Il éprouvait une indignation mêlée de mépris à la vue des litières qui servaient à traîner, d’une maison à l’autre, des hommes parfaitement capables de se servir de leurs jambes. Il ne comprenait pas que des êtres humains pussent se passer d’arbres et d’oiseaux, ni se résigner à vivre enfermés dans d’obscures boutiques, sans autre profit que de gagner un argent aussitôt dépensé. En un mot, il jugeait Péluse l’endroit le plus monstrueux du monde : et telle il continua de la juger pendant les six mois qu’il y demeura.
Car le fait est qu’il y demeura six mois, en dépit de sa mauvaise humeur : et ce fut bien là qu’il prêcha pour la première fois. S’étant rendu sur le port, le lendemain de son arrivée, il aborda quelques matelots qui musaient au soleil, et se mit à leur expliquer la doctrine chrétienne. Il la leur expliqua dans la langue grecque, qui était leur langue ; mais il répéta ensuite son explication en arabe à des marchands arabes qui s’étaient approchés ; il la répéta en syrien et en éthiopien, de telle sorte que, bientôt, une foule énorme se pressa autour de lui, curieuse d’entendre un homme qui parlait toutes les langues. Et Barsabas raconta à cette foule la vie et la mort divines de Jésus. Il leur raconta sa propre vie, de quelles ténèbres il avait été tiré, et vers quelle lumière. Il leur dit quelques-unes des paraboles de son maître, les plus simples et les plus touchantes, s’efforçant de retrouver, dans sa voix, un écho de la voix surnaturelle qui les lui avait enseignées. Longtemps il parla, debout sur un banc de pierre, indifférent aux injures comme aux railleries ; et d’heure en heure, à mesure qu’il parlait, injures et railleries devenaient plus rares, jusqu’à ce qu’enfin il eut le bonheur de voir jaillir des larmes presque de tous les yeux. Lui aussi, il pleurait ; une ardente émotion faisait frémir ses lèvres, donnait à sa parole des accents pathétiques. Quand il descendit du banc et cessa de prêcher, cent personnes de tout âge et de toute condition, s’approchant de lui avec déférence, lui exprimèrent leur désir d’être baptisées.
Et comme, quelques heures plus tard, Barsabas, tout heureux de la belle moisson qu’il avait rapportée à son maître dès son premier discours, s’en retournait joyeusement vers l’auberge où il s’était logé, un petit vieillard l’accosta dans la rue. C’était un aimable petit vieillard, chauve, replet, avec un visage ridé où s’ouvraient de grands yeux naïfs et bienveillants, Il avait la mise d’un riche bourgeois. Et, en effet, il apprit à Barsabas qu’il vivait de ses rentes, mais qu’il employait son temps à s’instruire et à méditer. « Or, je regrette d’avoir à vous dire, poursuivit-il, que votre Jésus n’est pas le vrai Dieu. Car le vrai Dieu, je le connais : il m’a été révélé par un homme admirable, le philosophe Épistrate, auteur du traité sur l’Essence de l’Être. Peut-être n’avez-vous pas lu ce livre sans pareil ? Tenez, je n’ai pas pu m’empêcher de vous l’apporter ! » – Et le vieillard tendait à Barsabas un épais rouleau. – « Je vous en prie, lisez-le ! Que si même il ne réussissait pas à vous convaincre tout à fait, vous y trouveriez encore de quoi réfléchir ! »
Le petit vieillard avait une si honnête et douce figure que Barsabas crut pouvoir lui parler comme à un ami. Il lui avoua donc qu’il lirait volontiers, pour l’obliger, le traité de son philosophe, mais que, par malheur, il ne savait pas lire. Et, loin de lui en témoigner le moindre mépris, le vieillard lui proposa aussitôt de lui apprendre lui-même à lire et à écrire. « Quelques leçons vous suffiront, lui dit-il, aidées d’un peu d’exercice. Et vous acquerrez là un bien inestimable, qui doublera l’effet de vos prédications ! »








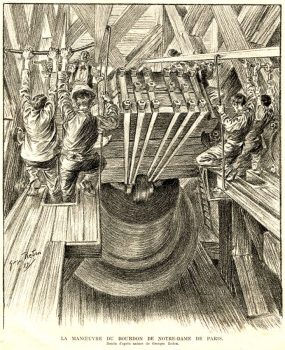
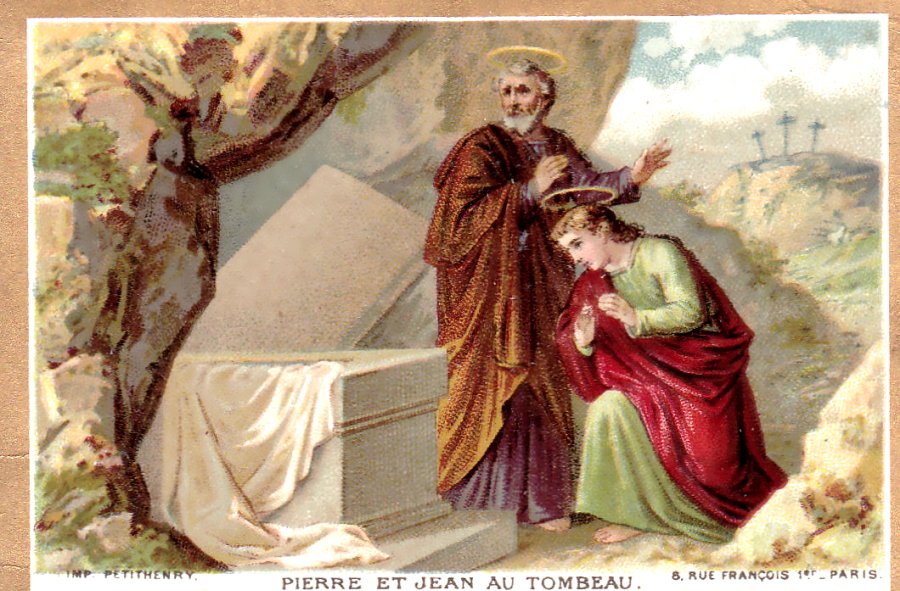
 Elle jeta un regard rapide dans l’intérieur du caveau, et croyant qu’on avait enlevé le corps, elle courut précipitamment au Cénacle avertir Pierre, qui était déjà considéré comme le Chef des Apôtres. Pierre et Jean sortirent aussitôt et coururent vers le tombeau. Madeleine les suivit de loin.
Elle jeta un regard rapide dans l’intérieur du caveau, et croyant qu’on avait enlevé le corps, elle courut précipitamment au Cénacle avertir Pierre, qui était déjà considéré comme le Chef des Apôtres. Pierre et Jean sortirent aussitôt et coururent vers le tombeau. Madeleine les suivit de loin.