Dans le pays d’Unamio, entre les terres riveraines de l’Océan Indien, alors sujettes du Sultan de Zanzibar, vivait au siècle dernier la petite Suéma.
Il est beau le pays de Suéma : immenses plaines couvertes d’arbres fruitiers, traversées par de jolis ruisseaux. Les indigènes y récoltent magnoc, ignames, patates, maïs et presque tous les légumes d’Europe.
Au delà des plaines, d’immenses forêts remplies de tigres, d’hyènes, de panthères, de lions, dont les rugissements, répercutés par les échos, semblent la nuit des roulements de tonnerre. Là, paissent d’innombrables éléphants dont les défenses fournissent un bel ivoire, principale ressource et richesse du pays.
Les Africains de cette région vivent en grande partie de la chasse.
« Père, puis-je aller chasser avec toi ? » a demandé souvent la petite Suéma.
— Non. Quand tu seras plus grande ! »
Aujourd’hui, le père a répondu : « viens ! »
La première opération consiste à creuser, dans divers endroits de la forêt, des fosses profondes que l’on recouvre de branchages et de hautes herbes. Ce travail terminé, hommes, femmes et enfants se réunissent pour la battue. Comme Suéma se sent en sécurité entre son père, sa mère et ses sœurs, malgré ses sept ans, elle se montre très brave.
Arrivée à la lisière du bois, la troupe des chasseurs forme la chaîne, puis, au signal donné, s’enfonce dans la forêt, resserrant son cercle à mesure qu’elle marche et poussant des cris aigus afin d’épouvanter et de déloger le gibier. Quelques hommes chargés d’arcs et de sagaies précèdent la bande ; d’autres, dispersés, veillent autour des trappes et pourchassent les animaux qui, par instinct ou par adresse évitent les pièges en sautant par dessus.
Ne soupçonnant aucun danger, Suéma sautille joyeusement entre sa mère et ses sœurs ; elle s’amuse tant qu’elle se croit à une partie de plaisir. Heureux et fier de sa fille, le père marche en avant, tenant une flèche toute prête sur la corde de son arc.
Les chasseurs se rapprochent de la ligne des trappes ; ils n’en sont plus séparés que par un bosquet touffu quand sort de ce bosquet un rugissement si rauque, si prolongé, que tous en restent pétrifiés. Le sang se fige dans les veines ; un silence de mort remplace les cris de la battue, mais laissons Suéma nous raconter elle-même la suite : « Tandis que les échos répétaient ce rugissement du lion, j’aperçus ce terrible animal qui, les yeux flamboyants, la crinière hérissée, battait la terre de sa longue queue. Il approche… sa marche un peu oblique le conduit directement vers nous… Il passe à côté de mon père puis s’arrête, prêt à bondir sur mes sœurs et sur moi. À ce moment même, il rugit d’une façon terrible. Mon père comprend qu’il n’y a pas un moment à perdre ; il s’élance et attaque l’animal ; ses flèches et ses sagaies toujours si sûres, manquent cette fois leur but. Alors, le couteau de chasse à la main, il se jette sur le lion et, avec ses bras crispés, saisit la crinière de l’animal.
« La frayeur m’a tellement glacée que je ne vois plus ce qui se passe ; c’est à peine si j’aperçois, dans un tourbillon de sang, une masse rouge qui roule à terre et disparaît dans la forêt. » Le lion, furieux, blessé, a emporté le père de la petite Suéma.
La battue cesse ; la forêt devient solitaire ; seuls les sanglots de la veuve et de ses filles interrompent le silence. La nuit les trouve au même endroit et les rugissements de l’hyène rappellent à la pauvre mère son dernier-né, resté à la maison.
Ce soir-là, pour la première fois, la case fut sans feu, triste et silencieuse. « Oh ! ajoutait Suéma, comme on souffre quand on ne connaît pas Dieu et qu’on ne sait pas le prier ! »
Les parents de Suéma n’avaient pas reçu comme nous les lumières de la foi ; mais fidèles à la loi naturelle, inscrite par Dieu en tout homme, ils faisaient simplement leur devoir. Comme la jeune Africaine parlait avec bonheur des jours de son enfance ! des bontés de son père, des soins dont l’entourait sa mère, de l’affection mutuelle qui les unissait tous : « J’entendais dire aux enfants des voisins : « Voilà l’heureuse Suéma qui mange tous les jours de la viande et du sel ! » J’étais fière de ces paroles parce qu’elles faisaient l’éloge de mon père. »
« On disait aussi quelquefois, en me voyant passer : « Voilà Suéma la propre, aux cheveux bien tressés. J’étais contente de ces paroles qui étaient l’éloge de ma mère. » Mais revenons aux tristes jours qui suivirent la mort du chef de famille.

Maintenant Suéma a autre chose à faire que de rire et de chanter en gardant les brebis avec les enfants de son âge ; elle cultive la terre avec ses aînées. Hélas, sur les récoltes s’abat un nuage de sauterelles ; ces insectes dévorent les plantes jusqu’à la racine et les arbres jusqu’à l’écorce. Ceux qui ont des réserves de sel ramassent des sauterelles et les mettent au saloir. Chez Suéma, impossible ! Le père est mort sans avoir dit où il prenait les plantes dont il extrayait ce sel si précieux parce que si rare en ce pays. Ces plantes existent-elles encore ? Les sauterelles ont tout dévoré !



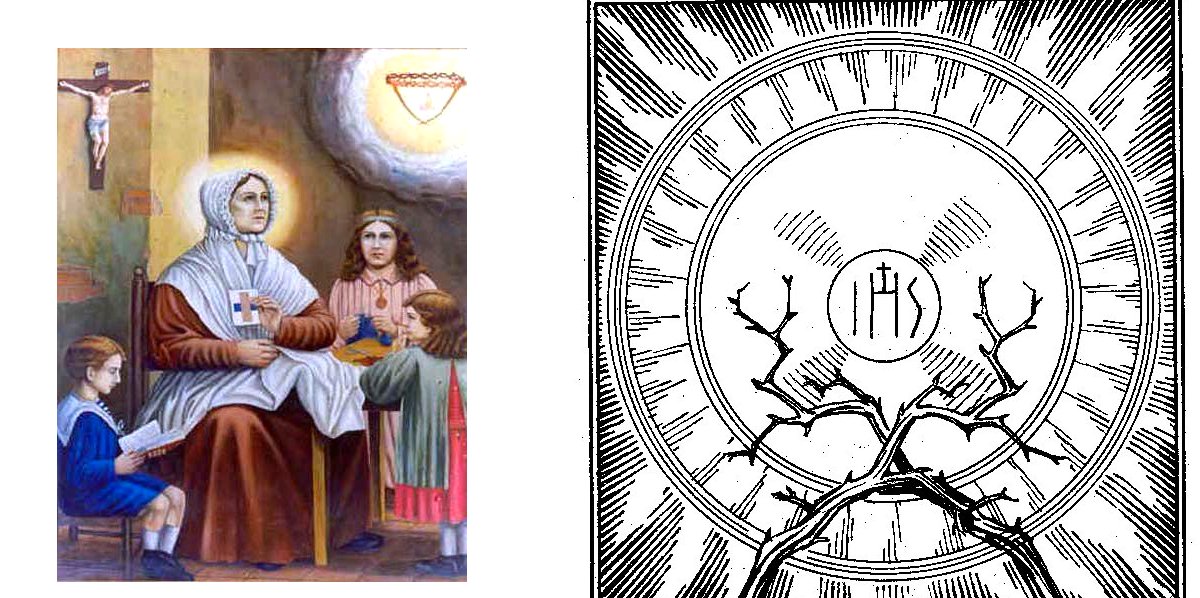



 Le pape Pie X eut la visite, un jour, d’un très riche Américain, qui comptait ses millions comme d’autres leurs écus. Au cours de la conversation, le Pape tira sa montre pour voir l’heure.
Le pape Pie X eut la visite, un jour, d’un très riche Américain, qui comptait ses millions comme d’autres leurs écus. Au cours de la conversation, le Pape tira sa montre pour voir l’heure.