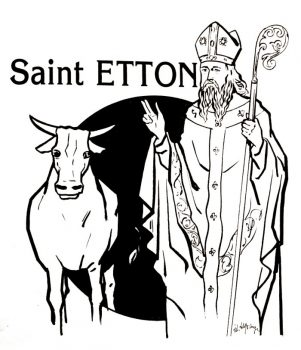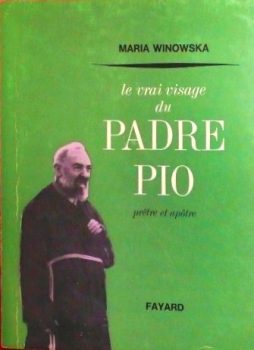VI
UNE heure passa ainsi, puis une autre. Jeanne s’appliquait aujourd’hui à faire toute chose avec plus de soin que d’habitude.
Ne désirait-elle pas offrir son zèle en sacrifice pour l’inconnu « perdu » ?
Apporter son petit tribut aux Saints, c’était la meilleure préparation pour la fête du lendemain.
Et il y avait tant à faire dans la maison et au jardin.
Au jardin, il fallait bien s’occuper un peu de ses frères. Ils étaient en train de construire dans le sable une grande forteresse.
— Qui sera seigneur de la forteresse ? Et Jeanne, qui sera-t-elle ?
Penchés tous trois au-dessus de leur château fort minuscule, ils avaient l’air de géants.
Jeanne prit le rôle de la bergère.
— Quel est le Dauphin ? François ou Bernard ?
Ce n’était pas une simple bergère.
Un morceau de carton remplaça le bouclier. La voilà prête au combat, prête à donner sa vie.
Que le Dauphin espère. Elle chassera l’ennemi hors des frontières.
— Je me confie à Dieu, dit Jeanne en se dressant devant Bernard.
— C’est bien, ma Pâquerette du Paradis, dit le Dauphin en lui remettant l’étendard…
Papa, à son retour de l’hôpital trouva ses enfants en plein jeu.
Il s’arrêta un instant et les embrassa d’un tendre regard.
VII
IL ne pouvait pas encore être question de préparer le repas à la maison.
C’était midi.
On décida d’aller au restaurant.
Papa ouvrit son journal.
— Va chercher maman, dit papa à Jeanne en posant une main caressante sur sa tête.
Jeanne se pressa pour monter l’escalier.
Au premier on ne percevait aucun bruit. Les chambres attendaient déjà toutes prêtes. Par la fenêtre donnant sur l’escalier on voyait un carré de ciel. Le jour était doux comme un jour d’adieu.
Jeanne monta au second étage et, pénétrant dans la première pièce, elle trouva sa mère.
C’était une petite chambre carrée, toute blanche, aménagée en chapelle.

Sur un tapis bleu il y avait contre le mur une table un peu surélevée et couverte d’une nappe brodée. Au-dessus se trouvait une croix d’ivoire, que Jeanne connaissait depuis toujours. Au-dessous deux vases étaient garnis de fleurs.
Maman se tenait à genoux devant le crucifix, le visage plongé dans les mains.
Jeanne regretta que papa ne fût pas là avec elles.