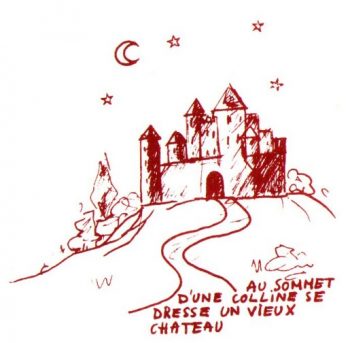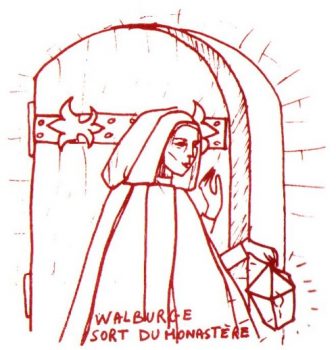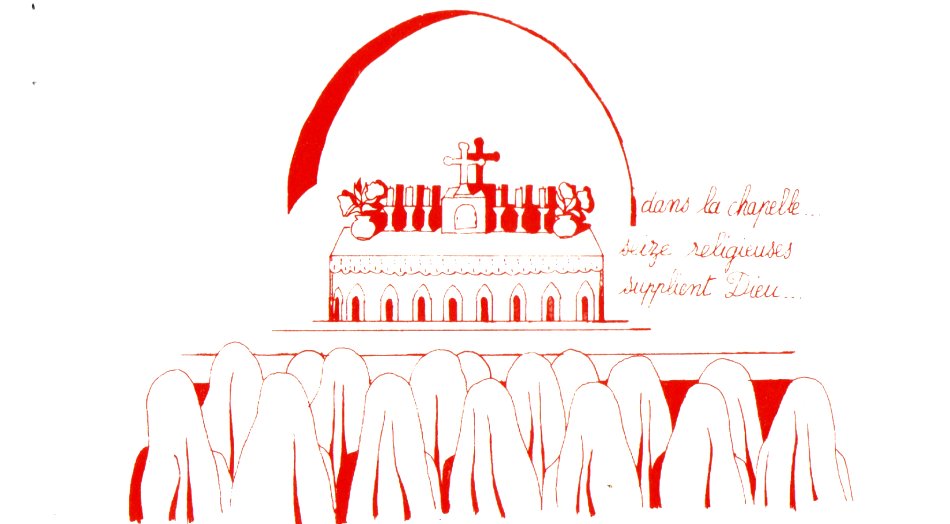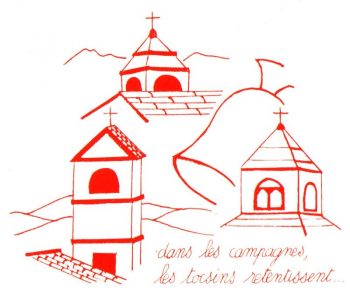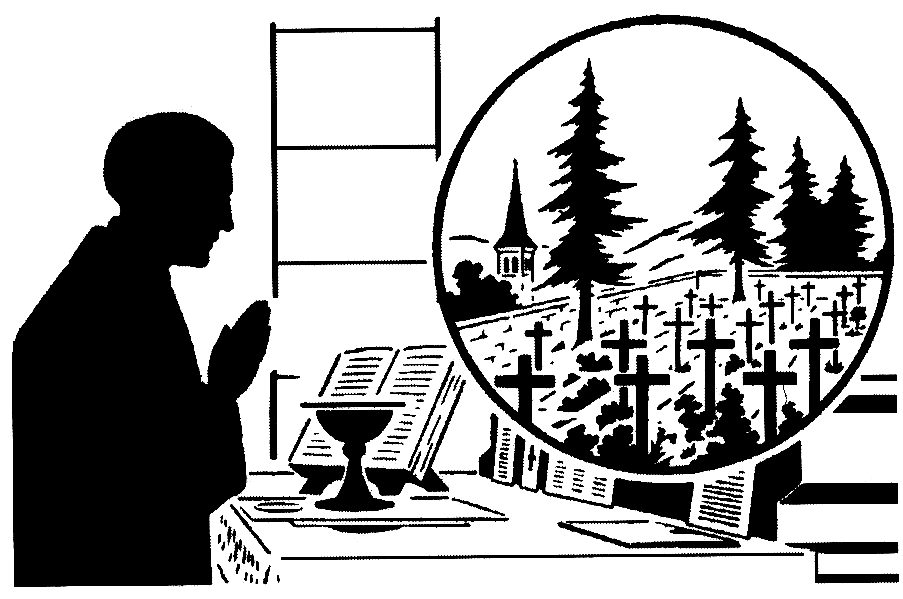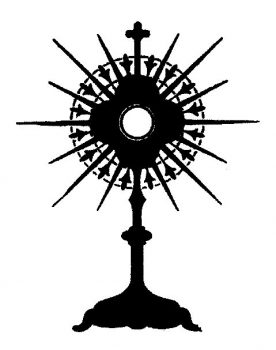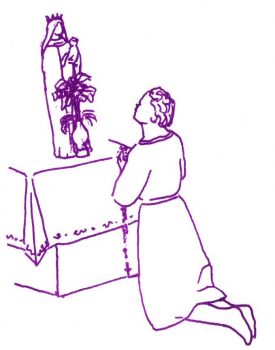.
Temps de lecture : 11 minutes Prêtre, rien que prêtre, pour offrir à Dieu le Saint Sacrifice de la Messe, administrer les sacrements et prêcher la parole de Dieu : ce fut toute la vie du saint Curé d’Ars. Il exercera si parfaitement son ministère que le XIXe siècle verra les foules accourir vers ce petit village des Dombes, pour « voir un saint ». Élevé à la gloire des autels, il sera donné comme patron aux prêtres. Pendant quarante-quatre ans il fut curé du village d’Ars, mais très vite, dix ans après son installation, déjà son ministère de convertisseur d’âmes commença. Il rendra ainsi la paix aux consciences tourmentées, consolera les affligés, dirigera vers la perfection de nombreuses âmes.
Prêtre, rien que prêtre, pour offrir à Dieu le Saint Sacrifice de la Messe, administrer les sacrements et prêcher la parole de Dieu : ce fut toute la vie du saint Curé d’Ars. Il exercera si parfaitement son ministère que le XIXe siècle verra les foules accourir vers ce petit village des Dombes, pour « voir un saint ». Élevé à la gloire des autels, il sera donné comme patron aux prêtres. Pendant quarante-quatre ans il fut curé du village d’Ars, mais très vite, dix ans après son installation, déjà son ministère de convertisseur d’âmes commença. Il rendra ainsi la paix aux consciences tourmentées, consolera les affligés, dirigera vers la perfection de nombreuses âmes.
Comment cet humble prêtre de campagne, peu doué intellectuellement, mais possédant la sagesse naturelle, y est-il arrivé ?
La trame de toute sa vie était l’Eucharistie : il en avait la passion. Il célébrait la Sainte Messe avec une telle ferveur, que l’opinion de ceux qui le voyaient à l’autel était qu’ils reconnaissaient Notre Seigneur « à la fraction du pain ». Une nuit de Noël, en célébrant la Messe, comme il attendait la fin des chants pour entamer le Pater, ceux qui étaient près de l’autel le virent, regardant la Sainte Hostie qu’il tenait entre ses doigts au-dessus du Calice, en pleurant et souriant en même temps. Son vicaire lui demandait, de retour à la sacristie : À quoi pensiez-vous à ce moment, Monsieur le Curé ? Mon ami, répondit-il, je disais à Notre Seigneur : Mon Dieu, si je savais devoir être damné maintenant que je vous tiens, je ne vous lâcherais plus.
Dès sa plus tendre enfance, cet amour de l’Eucharistie va se manifester ; il disait que c’était de sa mère qu’il en avait reçu l’exemple. J’ai appris à prier à la Messe rien qu’en la contemplant si recueillie et comme transfigurée.
Il fera sa Première Communion à douze ans. Sa joie était si grande après avoir reçu le Bon Dieu qu’il ne voulait plus quitter la chambre où il avait communié pour la première fois. À partir de ce moment, Dieu prit possession de son cœur et nul autre amour n’y pénétra. Élevé dans une famille profondément chrétienne, il passa sa jeunesse à l’abri du monde et dans l’ignorance du mal. Il reconnut qu’il n’en apprit l’existence qu’au confessionnal par la bouche des pécheurs.
L’éclosion de sa vocation au sacerdoce a certainement été influencée par les circonstances de son enfance. Né en 1786, il a quatre ans lorsque la persécution sanglante contre les prêtres fidèles commence. Ses parents vont très vite refuser d’assister à la Messe des prêtres jureurs et, au péril de leur vie, ils auront recours au ministère des prêtres proscrits pour recevoir les sacrements.
Combien l’âme si pieuse du jeune enfant sera impressionnée par ces Messes des Catacombes célébrées la nuit, dans des lieux secrets, par des prêtres pourchassés qui s’exposaient à la mort, à la déportation, par amour des âmes. Quand Jean-Marie confiera à sa mère son secret, il lui dira que c’est par amour des âmes qu’il veut se faire prêtre. L’époque était peu propice pour songer à la prêtrise et il fallut la ténacité du jeune homme aidé par sa mère très animée pour qu’il arrive à faire ses études en vue du sacerdoce.
C’est auprès de M. Balley, curé d’Ecully, qu’il sera envoyé ; en effet ce saint prêtre avait réuni autour de lui quelques jeunes gens pour les préparer à devenir prêtres. Il s’attachera très vite au jeune Vianney, car il s’était rendu compte de sa vertu peu commune. M. Balley sut inspirer à Jean-Marie une très grande vénération et Jean-Marie apprendra de ce curé austère et pieux ce que devait être le prêtre.
Jean-Marie ne sera ordonné qu’à vingt-neuf ans. Ces longues années d’études interrompues par des circonstances pénibles, ne feront qu’enraciner dans son âme le désir de monter un jour à l’autel.
Si certains de ses maîtres prêtèrent peu d’attention à sa vertu, d’autres ne se laissèrent pas tromper par sa rusticité apparente et comprirent qu’ils avaient affaire à un séminariste d’une piété exemplaire. M. Courbon, qui lui délivra ses lettres testimoniales à l’archevêché de Lyon, disait : L’Église n’a pas besoin seulement de prêtres savants, mais encore et surtout de prêtres pieux.
Il fut ordonné par Mgr Simon, évêque de Grenoble, le 13 août 1815. Il était seul et on fit la remarque à Monseigneur qu’on le dérangeait pour peu. Le vieil évêque contempla ce diacre au visage ascétique et dit : Ce n’est pas trop de peine pour ordonner un bon prêtre.
À partir du moment où Jean-Marie-Baptiste Vianney aura reçu le sacerdoce, on peut dire que l’homme va disparaître pour ne plus laisser paraître que le prêtre, cet autre Christ. Sans s’en rendre compte, tant son humilité était grande, le curé d’Ars s’est dépeint lui-même quand il parlera de l’éminente dignité du prêtre : Le prêtre ne se comprendra bien que dans le Ciel… Si on avait la foi, on verrait Dieu caché dans le prêtre comme une lumière derrière un verre comme du vin mêlé avec de l’eau.