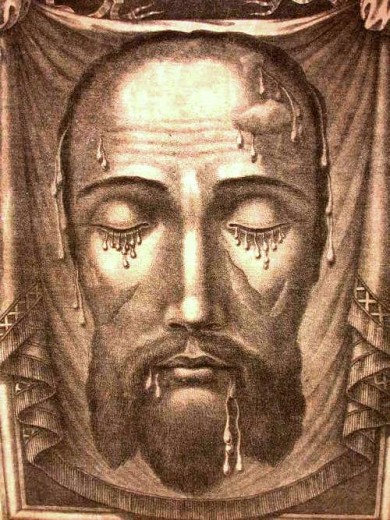Peu après la mort de sa femme, monsieur Martin liquida son commerce et, pour se rapprocher de son beau-frère, il vint habiter une propriété aux portes de Lisieux, « Les Buissonnets ».
« Les enfants aiment le changement ». Cette remarque de sainte Thérèse expliquera le bon souvenir qu’elle garda, ainsi que ses sœurs, de l’arrivée dans un Lisieux que ses usines rendaient pourtant bien terne au lendemain d’un Alençon égayé par les toujours coquettes demeures de cette ville si caractéristiquement normande.
Monsieur Guérin, l’oncle qui accueillit la famille Martin, était pharmacien. Avec sa femme, il formait un couple affectueux qui sut s’attacher immédiatement le cœur des cinq jeunes orphelines.
Puis c’est l’installation des Martin aux depuis célèbres « Buissonnets ». Non loin de la ville, un raidillon sortant de la route de Pont-Lévêque escalade une colline, pour mener aujourd’hui la foule des pèlerins aux « Buissonnets ». Au milieu d’un jardin abrité par des sapins et des frênes, c’était, à l’époque, la maison alors déjà très vieille, rustique, mais sympathique, que nous voyons, bâtisse ample, solide, colorée par ses briques rouges qui la rendaient attrayante.
La chambre que devaient se partager Céline et Thérèse, donnait de plain-pied dans le jardin de derrière.
Aux « Buissonnets », Pauline fut chargée de l’éducation de Thérèse. Cette dernière n’avait-elle pas choisi sa nouvelle petite maman ? La maladie, puis la disparition de madame Martin, avaient évidemment fait perdre plusieurs mois à l’instruction de l’enfant. Adroitement dirigée par son aînée, Thérèse délaissera ses jeux pour l’apprentissage de la lecture. C’est le mot « cieux » qu’elle sut le premier lire.
En peu de mois, la petite Thérèse a bien changé. L’espiègle s’est transformée : « Aussitôt après la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l’excès, un regard suffisait pour me faire fondre en larmes ; il fallait que personne ne s’occupât de moi, je ne pouvais souffrir la compagnie des étrangers et ne retrouvais ma gaîté que dans l’intimité de ma famille ».
Cet adoucissement du caractère contribue à faciliter la tâche de Pauline. Celle-ci, au lieu de rechercher pour sa sœurette l’occasion de satisfactions susceptibles de lui rendre son sourire perdu, ne craint pas au contraire de lui rappeler les saintes « pratiques », mais parfois elle doit cependant freiner l’ardeur pénitente de sa cadette.
Un exemple. Après ce jeu, il fait chaud, très chaud. Pauline et Thérèse sont devant une carafe d’une boisson rafraîchissante, Pauline s’en verse un verre, en tend un à sa jeune sœur. Thérèse refuse. « Oui, j’ai très soif, mais je vais offrir ce sacrifice à Jésus ! » Pauline, qui a exactement la même soif, peut certes apprécier ce sacrifice de Thérèse, aussi a‑t-elle pitié de l’enfant qui ne détache pas ses yeux de ce verre embué de fraîcheur. « Prends, Thérèse, prends cette boisson ! Jésus a recueilli ton sacrifice, fais-en un autre, d’obéissance celui-là, en acceptant de boire ! »
Et la vie se poursuivait aux « Buissonnets », vie normale, mais vie normale qui, dans l’âme de Thérèse avait des retentissements inattendus. Repassons quelques images de cette existence d’une enfant de cinq ans.
Le papa a fait cadeau à sa fillette d’une petite ligne pour pêcher. Thérèse lance dans la Touque sa petite ligne, quand monsieur Martin y va lancer sa grande ligne. Le paysage est gracieux, les poissons ne se font pas trop prier pour mordre aux deux lignes. Ce jeu devrait la passionner. Tiens, papa vient de prendre un poisson ! Peut-être va-t-elle en sortir un elle aussi ! Mais oui, elle en attrape justement un ! Dieu, que ce doit être amusant ! C’est amusant pour toutes les petites filles, ce n’est pas amusant pour Thérèse, dont l’esprit a déjà d’autres préoccupations, des préoccupations si belles mais si graves que bientôt elle abandonne sa ligne, s’assied sur l’herbe et, « là, écrira-t-elle plus tard, mes pensées devenaient bien profondes et, sans savoir ce que c’était de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J’écoutais les bruits lointains, le murmure du vent. Parfois la musique militaire m’envoyait de la ville quelques notes indécises, et « mélancolisaient » doucement mon cœur. La terre me semblait un lieu d’exil et je rêvais du Ciel. »
Cette pensée du Ciel est toujours la pensée dominante de Thérèse, elle l’obsède sans cesse et sous les formes les plus diverses, dont quelques-unes ne manquent pas de naïveté. Elle-même notera : « Je me souviens que je regardais les étoiles avec un ravissement inexprimable. Il y avait surtout, au firmament profond, un groupe de perles d’or, (le Baudrier d’Orion) que je remarquais avec délice, lui trouvant la forme d’un T, et je disais en chemin à mon père chéri : « Regarde, papa, mon nom est écrit dans le Ciel ! » Puis, ne voulant plus rien voir de la vilaine terre, je lui demandais de me conduire, et, sans regarder où je posais mes pieds, je mettais ma petite tête bien en l’air, ne me lassant pas de contempler l’azur étoilé ».
« La certitude d’aller un jour loin de mon pays ténébreux, m’avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais d’après ce que j’entendais dire, mais encore, je sentais dans mon cœur, par des inspirations intimes et profondes, qu’une autre terre, une région plus belle, me servirait un jour de demeure stable, de même que le génie de Christophe Colomb lui faisait pressentir un Nouveau Monde ».
Ce soir-là, le temps très sombre se zèbre soudain d’une série d’éclairs. Une fillette ordinaire aurait peur. Thérèse nous gardera le souvenir de ce qu’elle ressentait alors. « Je me tournais à droite à gauche, pour ne rien perdre de ce majestueux spectacle. Je vis la foudre tomber dans un pré voisin, et, loin d’en éprouver la moindre frayeur, je fus ravie ; il me sembla que le bon Dieu était tout près de moi ».
Et la Sainte fera elle-même le point de cette existence de petite fille prédestinée : « En grandissant, j’aimais le bon Dieu de plus en plus, et je lui donnais bien souvent mon cœur, me servant de la formule que maman m’avait apprise (Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le s’il vous plaît afin qu’aucune créature ne puisse le posséder, mais vous seul, mon bon Jésus !) Je m’efforçais de plaire à Jésus dans toutes mes actions, et je faisais grande attention à ne l’offenser jamais ».
Surtout ne pas offenser Dieu, même en jouant, sans faire exprès ! La domestique Victoire, qui mentit pour amuser cette enfant de six ans, s’attirera cette réprimande : « Vous savez bien, Victoire, que cela offense le bon Dieu ! »
La soirée aux « Buissonnets », on se distrayait autour de quelques jeux de société. Tactiques, on déplore le vilain hasard qui attribue une série de cartes faibles, on remercie le bon hasard qui permet d’échapper de très peu à la prison du jeu de l’Oye, on applaudit au succès, on est toujours heureux, on a du mal à contenir sa joie, tous s’amusent franchement.
Et, le jeu fini, c’est le retour au calme. Les aînées lisent à haute voix une page d’un auteur sérieux, peut-être trop sérieux pour alimenter la nuit durant l’esprit d’un enfant de six ou sept ans, aussi le papa fait-il toujours terminer la lecture par un conte, une bonne histoire qui fera rire. Lorsque la lectrice ferme son livre, monsieur Martin, sa petite Thérèse sur les genoux, chante les mélodies qu’aiment ses enfants, mélodies qui parfois s’éloignent de la douce mélopée lorsque, pour amuser la douce Thérèse, monsieur Martin chante d’une grosse voix la ritournelle cruelle de Barbe-Bleue.
Puis, c’est finalement la prière en commun et Thérèse, agenouillée à côté de son père, « n’a qu’à le regarder pour savoir comment priaient les saints ». Et, dans son petit lit, Thérèse demande à Pauline de lui faire la critique de sa journée : « Est-ce que j’ai été mignonne aujourd’hui ? Est-ce que le bon Dieu est content de moi ? Est-ce que les petits anges vont voler autour de moi ?» Si Pauline répond « non », Thérèse pleurera la nuit entière ».
La Fête-Dieu donne à l’enfant une première occasion de cette joie qu’elle aura plus tard à passer son Ciel à répandre des roses sur la terre. Oui, quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu ! « Mais, avant de les y laisser tomber, je les lançais bien haut, et je n’étais jamais aussi heureuse qu’en voyant mes roses effeuillées toucher l’ostensoir sacré ! »