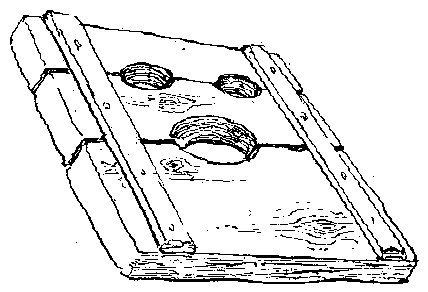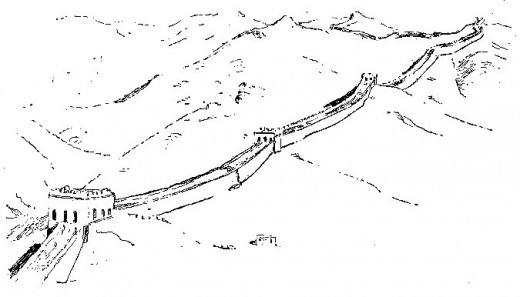Au château de Castiglione, en Lombardie, ce 20 avril 1568, c’était grande fête. Qui donc eût pu compter les noble invités dont la foule se répandait au long des salles immenses et à travers les jardins ? Les plus belles tapisseries pendaient au long des murs, somptueuses : des orchestres jouaient en vingt lieux différents ; dans les bassins du parc, les jets d’eau montaient, droits, comme pour rivaliser d’élan avec les cyprès centenaires. Tout était à la joie, au bonheur.
Pourquoi donc ? Parce qu’on baptisait, ce jour-là, un enfant, le fils du Marquis et de Donna Marta, le petit Louis ce bébé minuscule qui vagissait dans son berceau de dentelle. Demain n’hériterait-il pas d’une immense fortune Ne serait-il pas, comme ses ancêtres, Prince du Saint Empire, duc de Mantoue, grand d’Espagne ? Ne porterait-il pas un des noms les plus célèbres de toute l’Italie ? Un grand nom, en vérité, que celui des Gonzague, et une famille bien née ! Depuis deux siècles et demi que l’Empereur avait donné à leur aïeul, pour sa bravoure, titre princier et splendide dotation, il n’était génération de Gonzague qui ne se fût illustrée à la guerre, au service des Rois, ou dans l’Église. Toutes les familles, non seulement princières, mais même royales d’Europe, étaient apparentées aux Seigneurs de Mantoue, et c’était pourquoi, au baptême du petit Louis, on voyait tant de beau monde, et des Rois et des Ducs, et des Cardinaux en rouge, et des ambassadeurs portant maints uniformes éblouissants, parmi lesquels on remarquait ceux de Sa Majesté Philippe II, roi de Naples et d’Espagne, car Donna Marta avait été dame d’honneur de la reine, Madame Élisabeth de France, et son amie.
Cette joie était peut-être encore plus grande parce qu’on n’ignorait point qu’il s’en était fallu de peu qu’elle eût été remplacée par un grand deuil. Lorsqu’au début de mars le petit Louis était né, les médecins avaient tremblé non seulement pour sa vie mais aussi pour celle de sa mère. Et Donna Marta, dans cet extrême danger, avait fait deux vœux. « Oh, Sainte Mère qui, du haut du Ciel, veillez sur nous, vos enfants de la terre, si mon petit vit, si j’échappe moi aussi au péril, je jure d’aller vous prier en pèlerinage, dans la basilique de Lorette où l’on voit votre Sainte Maison apportée du ciel par les Anges ! Et mon enfant vous sera consacré spécialement pour toute son existence ! »
Aussi quand on parlait, parmi les invités du baptême, de ce que serait, plus tard, le nouveau-né, — comme son père et ses oncles, comme le fondateur de la famille dont il portait le prénom, serait-il un grand soldat, un vaillant capitaine ? irait-il batailler en Allemagne ou en France, voire jusque contre les Turcs ? — la mère, elle, dans la foi de son âme et la reconnaissance de son cœur, souhaitait qu’il ne fût rien de moins qu’un Saint.
* * *
 Il faut avouer que, dès sa plus petite enfance, Louis — Luigi comme on dit en italien, — sembla bien être destiné à se montrer un chrétien exceptionnel, en même temps qu’il parut très spécialement protégé de Dieu. À peine savait-il marcher qu’il se dirigeait vers la statue de la Sainte Vierge, devant laquelle Donna Marta renouvelait les fleurs les plus belles en faisant sans cesse brûler douze cierges, et là, immobile, étrangement sage, il regardait… À peine savait-il parler que déjà il récitait des prières et que ses mots les plus familiers étaient : Jésus ! Marie ! Dès qu’il eut l’âge de raison, on le vit multiplier les exercices de piété, avec une application si étonnante pour son âge que son père, un peu inquiet, craignant que son aîné, au lieu de le remplacer à la tête de ses états, se fît moine, parfois venait l’interrompre dans ses prières et ordonnait à quelque écuyer de le mettre sur son petit cheval pour l’emmener faire quelque bonne promenade à travers la campagne et lui changer les idées.
Il faut avouer que, dès sa plus petite enfance, Louis — Luigi comme on dit en italien, — sembla bien être destiné à se montrer un chrétien exceptionnel, en même temps qu’il parut très spécialement protégé de Dieu. À peine savait-il marcher qu’il se dirigeait vers la statue de la Sainte Vierge, devant laquelle Donna Marta renouvelait les fleurs les plus belles en faisant sans cesse brûler douze cierges, et là, immobile, étrangement sage, il regardait… À peine savait-il parler que déjà il récitait des prières et que ses mots les plus familiers étaient : Jésus ! Marie ! Dès qu’il eut l’âge de raison, on le vit multiplier les exercices de piété, avec une application si étonnante pour son âge que son père, un peu inquiet, craignant que son aîné, au lieu de le remplacer à la tête de ses états, se fît moine, parfois venait l’interrompre dans ses prières et ordonnait à quelque écuyer de le mettre sur son petit cheval pour l’emmener faire quelque bonne promenade à travers la campagne et lui changer les idées.
Louis, si petit qu’il fût, avait déjà son intention bien arrêtée. Il aimait à répéter : « Ce que le Bon Dieu veut, il le fait : il n’y a qu’à avoir confiance ! » Reconnaissons que cette confiance était bien placée et que le Tout-Puissant y répondait ! Car, à plusieurs reprises il fut évident que Dieu lui-même le protégeait, ayant sur lui des vues sans aucun doute. Ainsi, par exemple, lorsqu’il avait cinq ans, il regardait un soldat charger un mousquet ; la charge de poudre éclata tout à coup en pleine figure de l’enfant ; on le pensa brûlé, défiguré, aveugle ; mais il s’essuya tranquillement le visage où aucune trace ne se voyait. Une autre fois, avec ses camarades, il s’amusait à manœuvrer un petit canon qu’on lui avait donné comme jouet ; l’un d’eux s’étant trop pressé de mettre le feu à la mèche, le recul de la pièce heurta Luigi en pleine poitrine et le renversa, mais tandis qu’on se précipitait, le croyant mort, il se relevait en riant.
Confiance, confiance en Dieu ; faire ce que veut le Christ et s’en remettre à lui de tout ; tels étaient ses principes, qu’il ne cessait de répéter avec une obstination douce. Cette confiance, il l’exprima un jour dans une réponse si jolie qu’il ne faut pas la laisser perdre. Il jouait dans la cour avec quelques garçons à ce jeu qu’on appelle « la balle au chasseur ». Monseigneur l’aumônier, qui était chargé de surveiller son éducation religieuse, s’approcha de lui et lui dit :