On est à la Noël. Partout dans la campagne, sur la vaste étendue, les longues routes blanches sont constellées. Entre leur bordure verte de sapins, — ces bouées fleuries, guides du voyageur dans la plaine immense et nivelée par l’hiver, — on les voit courir et se croiser à travers les champs combles.
Et c’est comme une procession, ce long cortège de traîneaux venant de toutes parts, s’acheminant tous vers l’église du village.
La rosse qui les tire, indifférente au froid comme à la gravité de l’heure, trotte sans hâte, d’un pas égal et rythmé.
De ses naseaux l’haleine s’échappe en fumée lumineuse ; mais cette ressemblance lointaine avec les coursiers olympiens, dont les narines flamboyantes lancent des éclairs, en est une bien trompeuse cependant, car, voyez la pauvre bête — par exemple la dernière là-bas, avec cette lourde charge — les ardeurs guerrières sont depuis longtemps mortes en sa vieille charpente.
D’un contentement égal elle porte au marché les poches pleines, ou, comme en ce moment, la famille à la messe de minuit.
Le pauvre cheval n’est pas né du printemps.
Cette demi-douzaine de marmots qu’il traîne là, et d’autres encore qu’on a laissés à la maison, s’il ne les a pas vus naître, du moins les a‑t-il tous, chacun à son tour, menés à l’église petits infidèles, pour les en ramener petits chrétiens.
L’histoire de ces vieilles bêtes est celle de leur maître.
Jeune et fringant, le bon animal brûla jadis le pavé pour conduire chez « sa blonde[1] » le père d’aujourd’hui. Et, depuis, ils cheminent ensemble dans la vie, se supportant réciproquement, travaillant côte à côte, indispensables l’un à l’autre, se retrouvant toujours aux heures solennelles, aux moments d’urgence, moments où le plus humble des deux devient parfois le principal acteur.

Quand il s’agit, par exemple, de longues courses pressées, l’hiver, par les chemins débordés, au milieu de la « poudrerie » que soulève l’aquilon ; l’automne, quand le pied s’embourbe et se dégage avec peine dans les sentiers boueux, et l’été sur les routes sans ombrage.
Élément obligé des joies de la famille, il conduit aujourd’hui « les enfants » à la messe de minuit ; cette fête unique pour les petits et les simples ; fête mystérieuse où ils retrouvent dans la touchante et poétique allégorie de la Crèche, la reproduction tangible, comme une incarnation des choses vagues et douces, du merveilleux qu’ils voient parfois flotter dans les rêves de leur sommeil paisible ou dans les fantaisies de leur imagination naïve.
Les deux plus jeunes de ces six heureux, enfouis, émus et recueillis, dans le fond du traîneau, y viennent pour la première fois.
- [1] Au Quebec, « une blonde », c’est une fiancée↩





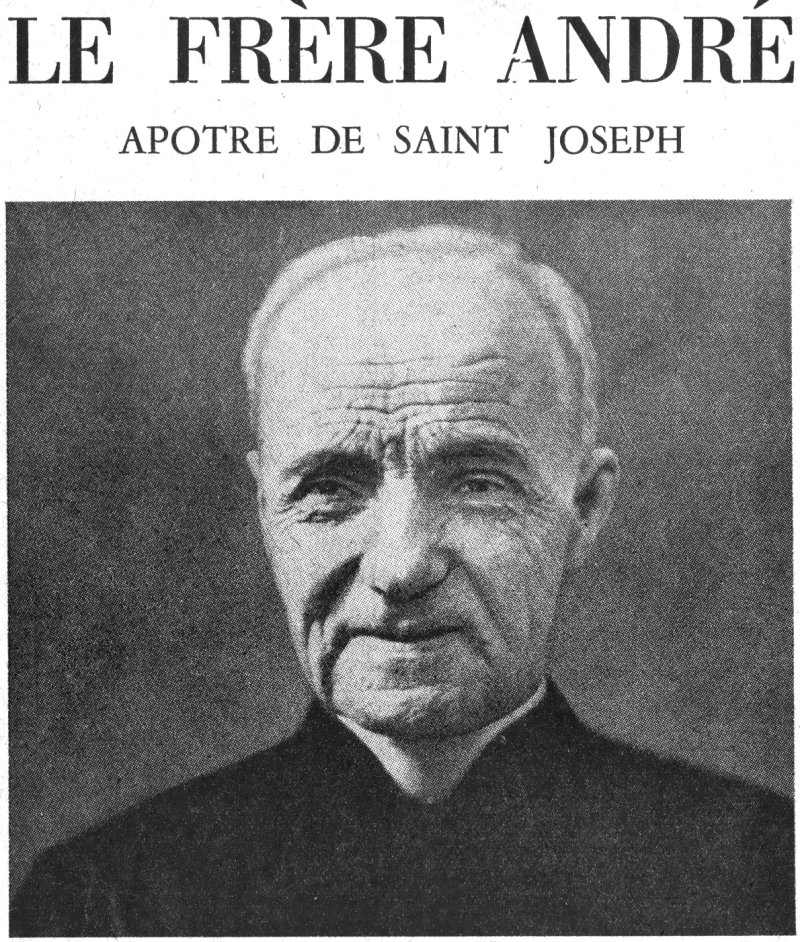
 Messire Provençal, curé de Saint-Césaire, au
Messire Provençal, curé de Saint-Césaire, au 

