.
Temps de lecture : 24 minutes Saint Jean-François Régis naquit le 31 janvier 1597 à Fontcouverte, à égale distance de Narbonne et de Carcassonne. Fontcouverte, Fontaine couverte, source cachée, est une place forte de modèle réduit : trente maisons protégées par un châtelet appartenant au seigneur abbé de La Grasse.
Saint Jean-François Régis naquit le 31 janvier 1597 à Fontcouverte, à égale distance de Narbonne et de Carcassonne. Fontcouverte, Fontaine couverte, source cachée, est une place forte de modèle réduit : trente maisons protégées par un châtelet appartenant au seigneur abbé de La Grasse.
Aujourd’hui, c’est saint Jean-François Régis qui protège Fontcouverte et la précieuse source est découverte : le village allait donner naissance à un saint !
Jean de Régis, père du bébé, a noté sur son livre de raison, d’une belle écriture moulée par la plume d’oie : « L’an mil-cinq-cent-nonante-sept, le dernier jour de janvier, un divendrès (dies veneris : vendredi) es nasqut notre enfant, Jean-François. Et fut parrin noble Francis de Turin, dit de Brètés, seigneur et baron de Pécheiriq, la marrine damoiselle Clare Daban, famé à mon frère Régis. »
C’est là l’acte de naissance du Saint. Jean-François Régis naquit le même jour à la vie de l’âme, puisque son père ajouta sur son livre de famille : « Et fut baptisé à l’église de Fontcouverte. » Encore un saint qui a été baptisé le jour même de sa naissance. Remarquons le fait, sans prétendre cependant en tirer une conclusion catégorique, car, à cette époque, présenter un enfant du jour au baptême était une pieuse coutume généralement observée dans les familles catholiques.
Le père et l’oncle du Saint tiraient quelque gloire de leur titre de « capitaine et gendarme de la compagnie de Monseigneur le Maréchal de Joyeuse. » Mais il s’agissait de gens d’armes de réserve ! La foi de ces deux braves leur faisait un devoir de répondre immédiatement à tout appel des chefs ligueurs pour combattre les troupes huguenotes. Les deux seigneurs de Régis étaient plutôt, à la vérité, des gentilshommes terriens, de modestes gentilshommes qui ne négligeaient point d’aider de leurs propres mains les quelques domestiques qui semaient, coupaient, battaient et engrangeaient les blés, récoltaient les fruits dorés au chaud soleil de Provence. On voyait même les deux « gens d’armes » mettre la main aux mancherons de la charrue.
La demeure des Régis est éloignée de tout luxe, elle ne montre point les proportions d’une gentilhommière. Composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage couvert d’un grenier, son seul orgueil est de renfermer deux grandes pièces de six mètres de côté, dans lesquelles les Régis reçoivent, mais bien rarement, les hobereaux du voisinage.
Rude à la guerre, rude au travail de ses champs, le père de Jean-François est cependant un homme de manières douces qui ne contrarierait en rien sa jeune femme, Madeleine d’Arse. Celle-ci est malheureusement de santé si délicate qu’elle doit renoncer à nourrir elle-même son bébé, qui est son second enfant. La marraine, Clara Daban, demande à se charger de son filleul. Elle lui trouvera bien une nourrice sur ses terres. Et c’est ainsi que Jean-François deviendra pour longtemps « le nourrisson de Moux », localité proche de Fontcouverte.
Cette nourrice est entrée dans la légende, sinon dans l’Histoire. S’étant absentée, elle retrouve le bébé sous le berceau, « développé de ses langes, sain et gaillard ». La bonne femme, qui a eu fort peur, accuse les sorciers d’avoir voulu du mal au fils des Régis ; elle ne peut songer à accuser le démon qui aurait certainement aimé se débarrasser, dès le berceau, d’un grand saint qui allait lui causer un tort considérable en lui ravissant des milliers d’âmes.
Et l’enfant grandit aux côtés de son frère aîné Charles, car Madeleine d’Arse a retiré son fils de Moux dès qu’il a pu supporter le lait de vache. La jeune femme a une trop belle idée de l’éducation pour abandonner la formation de l’enfant au seul bon vouloir d’une nourrice paysanne. La brave femme ne lui enseignerait que le bien, mais elle se serait vite trouvée débordée par l’intelligence précoce de Jean-François, dont les innombrables questions ne laissaient pas un instant de répit à sa maman. C’était évidemment les habituels : « Maman, qu’est-ce que c’est que cela ?… Maman, ça sert à quoi, cela ?… Et pourquoi dit-on cela ?… » Parfois, l’enfant ne posait pas suffisamment de qestions pour contenter son insatiable curiosité, puisqu’il lui arrivait de se former un dictionnaire à lui, un vocabulaire qui attribuait aux mots un sens qu’ils n’avaient point !
Pour exemple, jugeons de l’étonnement et de la frayeur de Madeleine d’Arse lorsque, promenant par la main son Jean-François de cinq ans, celui-ci lui déclara « sautelant » à son côté, joyeux :
— Ma mère, je serai damné !…
La maman s’arrête, regarde son fils dans ses yeux rieurs et si vifs :
— Mon petit, voyons, tu ne sais pas le sens terrible du mot damné ! Dieu te garde d’un tel malheur !…
Et, à Jean-François très attentif, Madeleine d’Arse donne une leçon de catéchisme, que l’enfant clôture par cette promesse joyeuse :
— Alors, au Ciel ! ma mère ! au Ciel !
Enfant, Jean-François faisait déjà preuve de nombreuses qualités de base, telles que la modestie, la retenue, la bienséance. Mais il ne faudrait point songer à trouver de la tristesse chez ce bambin méridional ! Non, Jean-François, ses heures de classe terminées, se précipitait de toute la vitesse de ses petites jambes pour jouer avec ses camarades sous les platanes du mail de Fontcouverte. Il était parfois précédé de Charles, son aîné, mais il avait la gentillesse d’entraîner par la main ses deux petits frères, Jean et François.
Il est amusant de constater que la maman aimera donner à nouveau à ses deux autres enfants les mêmes prénoms qu’à son cher Jean-François. Autre curiosité : le nom de famille du saint, Régis, deviendra un prénom habituel, même très souvent donné au baptême des garçons. Cette coutume est relativement rare, et on ne peut citer que quelques saints dont les noms de famille ont été ainsi transformés en prénoms usuels : sainte Jeanne de Chantal, saint Louis de Gonzague, saint François Xavier.
Et voici l’âge de l’école. Jean-François fréquentera l’école du village, mêlé aux petits camarades, mêlé aux enfants des serviteurs de son père. Il étudie comme les autres, mieux que les autres, et puis, brusquement, moins bien que les autres.
Cet enfant possédait une sensibilité extraordinaire. « On pouvait le châtier avec les yeux, et toutes les fautes étaient toujours trop punies par une mine un peu sévère. » Les parents avaient l’intelligence de ne point abuser de cette facilité de correction, mais il advint qu’un des premiers maîtres de l’enfant crut pouvoir se permettre d’user envers lui « d’un peu de rigueur ». Le résultat fut à ce point pitoyable que « ses parents désespéraient déjà de le voir jamais capable de bonnes lettres. »
Par bonheur, rapportent les premiers historiens du saint, « sa mère, qui l’étudiait tous les jours, s’aperçut que la sévérité de son maître étouffait les lumières de son esprit. Elle le pria donc de changer de batterie et de le conduire avec douceur, ce qui lui réussit si heureusement que, se voyant caressé, il commença à s’épanouir en sorte qu’il apprenait plus qu’on ne voulait ».
Jean-François étudiait la langue française tout en continuant à parler couramment le languedocien avec ses parents et ses camarades de classe et de jeux. Peut-être était-ce la Providence qui préparait ainsi le futur saint à ses missions dans les montagnes cévenoles, où il ne parlera que le languedocien à ces bonnes gens, qui n’auraient pas saisi grand’chose d’un sermon en pur français. Nous ne sommes qu’au XVIIe siècle.
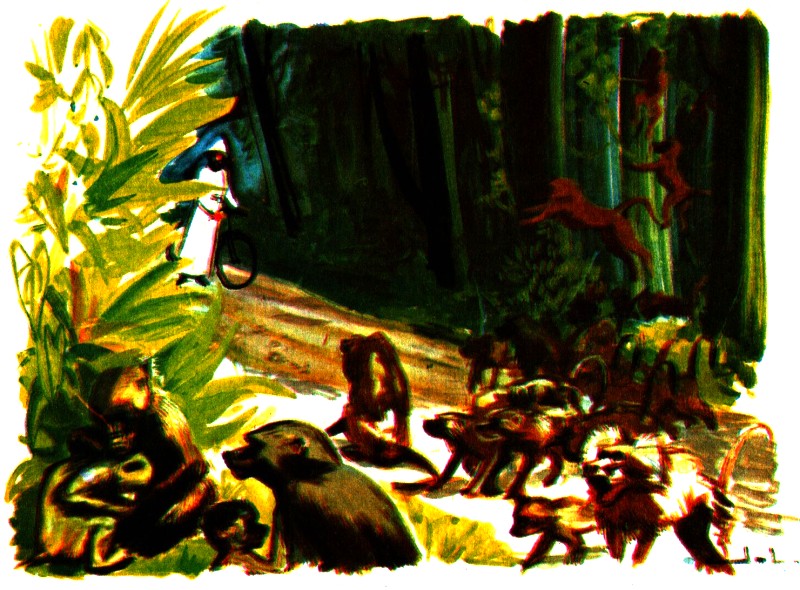








 « Il faut envoyer cet enfant à la campagne. Mettez-le petit berger dans une bonne famille de cultivateurs, vous verrez comme cela lui fera du bien ; l’âme et le corps y gagneront.
« Il faut envoyer cet enfant à la campagne. Mettez-le petit berger dans une bonne famille de cultivateurs, vous verrez comme cela lui fera du bien ; l’âme et le corps y gagneront.