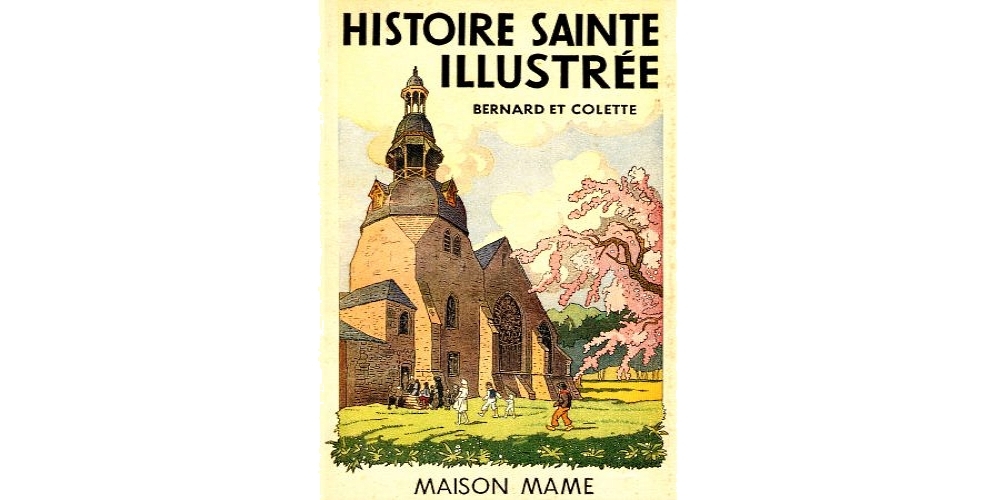.
Temps de lecture : 27 minutesNous devons ajouter que Barsabas, de plus en plus absorbé par sa science, s’apercevait à peine des progrès de sa renommée. Mais il ne put se défendre d’un secret plaisir quand, un jour, la femme d’un des principaux fonctionnaires romains le fit prier de venir chez elle lui donner des leçons. Cette dame n’était plus très jeune, et Barsabas, qui avait eu déjà l’occasion de la voir, ne se souvenait pas non plus qu’elle fût bien jolie. Il se rendit pourtant à son invitation et trois leçons lui suffirent, sinon pour la transformer en cosmopolite, du moins pour changer d’opinion sur elle.
À défaut de jeunesse, et presque de beauté, elle était infiniment élégante, gracieuse, spirituelle, experte en sourires provocants et en douces flatteries. Elle fit à son professeur un accueil où, de la façon la plus piquante du monde, le respect se tempérait de familiarité. Elle l’admira, l’amusa, lui inspira la plus haute idée d’elle-même et de lui. Et son mari, à qui ensuite elle le présenta, l’invita à venir dîner chez eux aussi souvent qu’il voudrait.
Alors s’ouvrirent pour Barsabas des semaines si heureuses, que peu s’en fallut qu’il n’oubliât, par instants, de se désoler des lacunes de sa science. Tous les soirs, assis près de son élève, il se sentait rajeunir, en même temps que son élève rajeunissait à ses yeux. Tendrement, humblement, il lui faisait l’aveu de ses ambitions et de ses déboires : et elle, en échange, avec un sourire ingénu de ses dents toutes neuves, elle lui racontait son enfance, la mort d’un petit oiseau qu’elle avait nourri. Mais surtout elle le ravissait par sa passion de s’instruire. Elle lui demanda de l’emmener avec lui, dans son prochain voyage ; et bien que Barsabas, craignant pour elle les incommodités des auberges lointaines l’eût simplement conduite en Sicile, jamais aucun de ses autres voyages ne lui parut si charmant. Il montra à son amie le berceau d’Empédocle, il lui exposa la doctrine de ce philosophe, il lui apprit à nommer, dans toutes les langues, les fleurs qu’il cueillait pour elle au bord des sentiers. De retour à Rome, où ils étaient revenus par le plus long chemin, ils se promirent de vivre désormais tout entiers l’un pour l’autre. La dame se fit faire une robe à l’égyptienne, dont elle prit le modèle sur un vase que son ami lui avait donné. Et l’ami, afin de placer ses travaux même sous l’inspiration de sa chère maîtresse, forma le projet d’étudier les formes diverses des sentiments de l’amour chez les divers peuples.
 Mais le hasard voulut que cette aventure, qui avait mis le comble à sa fortune, fût aussi l’origine de tous ses malheurs. Moins de quinze jours après être revenue avec lui de Sicile, la dame lui signifia qu’elle ne pourrait plus recevoir ses leçons ; et il apprit qu’elle s’était déjà choisi pour professeur un autre savant, nouvellement arrivé à Rome. C’était un jeune Grec de Chypre qui, tout comme Barsabas, possédait un don extraordinaire ; mais son don, à lui, était de l’ordre mathématique : il consistait à savoir résoudre, séance tenante, les problèmes de calcul les plus compliqués. Dix chiffres à multiplier par dix autres ne semblaient rien qu’un jeu pour la prodigieuse mémoire du jeune Cypriote, qui se trouvait être, avec cela, fort bel homme, laissant voir des formes d’une admirable vigueur sous le costume bizarre dont il s’affublait. Aussi ne parlait-on que de lui ; et le bruit qu’il faisait avait, dès le premier jour, indigné Barsabas, qui, certes, ne se fût jamais attendu à devoir céder à un tel homme le cœur de son élève.
Mais le hasard voulut que cette aventure, qui avait mis le comble à sa fortune, fût aussi l’origine de tous ses malheurs. Moins de quinze jours après être revenue avec lui de Sicile, la dame lui signifia qu’elle ne pourrait plus recevoir ses leçons ; et il apprit qu’elle s’était déjà choisi pour professeur un autre savant, nouvellement arrivé à Rome. C’était un jeune Grec de Chypre qui, tout comme Barsabas, possédait un don extraordinaire ; mais son don, à lui, était de l’ordre mathématique : il consistait à savoir résoudre, séance tenante, les problèmes de calcul les plus compliqués. Dix chiffres à multiplier par dix autres ne semblaient rien qu’un jeu pour la prodigieuse mémoire du jeune Cypriote, qui se trouvait être, avec cela, fort bel homme, laissant voir des formes d’une admirable vigueur sous le costume bizarre dont il s’affublait. Aussi ne parlait-on que de lui ; et le bruit qu’il faisait avait, dès le premier jour, indigné Barsabas, qui, certes, ne se fût jamais attendu à devoir céder à un tel homme le cœur de son élève.
Ce cœur que, la veille encore, il avait senti tout à lui, il ne se résigna pas à le perdre avant d’avoir tenté de le ressaisir. Ne pouvant plus donner de leçons à la dame, il pouvait, du moins, continuer à dîner chez elle. Il y vint dîner, le soir même ; et le mari eut pour lui des prévenances qui lui rendirent courage. Mais elle, au contraire, fuyait ses regards, ou bien parfois lui lançait un rapide coup d’œil mêlé de mépris et de compassion.
Il finit par l’aborder, au sortir de table. Il lui rappela ce qu’il était, la gloire et les honneurs que son savoir lui avait valus. Elle-même, souvent, ne lui avait-elle pas répété qu’il résumait en lui l’âme universelle ? Ne s’était-elle pas émerveillée, chaque jour davantage, de la profondeur et de l’étendue de son cosmopolitisme ? Et c’était lui qu’elle voulait maintenant sacrifier à un faux savant, à un baladin de l’espèce de ceux qui dansaient dans les foires !
Mais la dame, qui sans doute avait hâte de rejoindre son nouveau professeur, ne prit pas la peine de lui répondre en détail. « Mon pauvre ami, – lui dit-elle, – je croyais vous avoir assez payé de vos leçons ; puisque vous paraissez en juger autrement, je vais donc achever de m’acquitter envers vous en vous donnant, à mon tour, deux conseils précieux. D’abord, quand vous dînerez dans une maison romaine, évitez de manger votre viande avec vos doigts : rien ne nuit autant à votre réputation de citoyen du monde ! Et puis, si l’un des convives vous parle de Virgile, n’affirmez pas que c’est un mauvais poète, ainsi que vous venez de le faire tout à l’heure : avouez plutôt que, étant étranger à Rome, vous êtes hors d’état de comprendre le génie de nos poètes ! » Sur quoi elle lui tourna le dos et s’enfuit dans la salle voisine, après lui avoir adressé un dernier sourire qui, seul, aurait suffi pour lui ôter toute envie de la suivre.
Mais, au reste, Barsabas n’en avait plus nulle envie, car son amour s’était éteint d’un seul coup, comme une petite flamme sous un souffle de vent. Il s’empressa de rentrer chez lui, et jusqu’au lendemain il se promena fiévreusement parmi ses livres épars, songeant à l’injustice monstrueuse des deux reproches qu’il venait d’entendre.
Le premier de ces reproches, à dire vrai, n’était pas sans quelque fondement. Oui, en effet, malgré son cosmopolitisme, Barsabas sentait qu’il avait gardé les rudes allures d’un paysan de la Galilée. Il n’avait pu se contraindre à manger, ni à marcher, ni à se vêtir de la manière dont le faisaient, autour de lui, les véritables Romains. Ses toges avaient beau lui coûter fort cher, jamais il n’avait pu apprendre à les bien porter. Et il sentait aussi qu’il parlait trop vite, et que ses éclats de rire étaient trop bruyants. Mais, n’attachant lui-même à ces menus détails aucune importance, il n’admettait pas que personne leur en attachât ; tandis que le second reproche, au contraire, l’avait atteint au vif, si au vif que c’est en l’entendant qu’il avait soudain cessé d’aimer son élève. Virgile ! On osait lui reprocher de ne pas comprendre ce mauvais poète ! N’avait-il pas durant six mois, l’hiver précédent, étudié en public les Églogues et l’Énéide, au double point de vue étymologique et grammatical ? N’avait-il pas soumis le texte de ces poèmes à l’analyse la plus rigoureuse, relevant à chaque vers des expressions impropres, des images forcées, des fautes de grammaire ou de prosodie ?
Ce qu’il ne comprenait pas, en effet, et qui depuis longtemps déjà l’exaspérait, c’était le culte superstitieux des Romains pour Virgile. Ce même soir, au dîner, un jeune voisin de table lui avait raconté qu’il avait passé la nuit précédente à relire l’Énéide, et qu’il avait été plus ravi que jamais de la divine harmonie qui s’en dégageait. Pareillement, des Grecs lui avaient parlé de la volupté que leur causait « l’harmonie » de Sophocle ; et dans tous ses voyages il avait rencontré des lettrés qui lui avaient vanté « l’harmonie » de leurs poètes locaux. Et lui, désireux de prendre sa part de leur émotion, il avait lu et relu tous ces poètes : quelques-uns d’entre eux lui avaient paru plus ingénieux, plus savants, plus corrects que les autres ; mais, chez ceux-là même, il n’avait pu découvrir aucune trace de cette mystérieuse « harmonie » que se plaisaient à leur prêter leurs compatriotes. Qu’était-ce, au surplus, que cette harmonie ? À quel signe la reconnaissait-on ? Et à quoi servait-elle ? Et comment un Romain ou un Grec pouvait-il la trouver dans sa langue, alors que lui, Barsabas, qui savait toutes les langues, n’était parvenu à la trouver nulle part ?
Et cependant, à y réfléchir, il se souvint de l’avoir, lui aussi, jadis, trouvée quelque part. Il se souvint que jadis, dans son village, rien ne lui plaisait autant que d’entendre réciter certains poèmes en patois galiléen, des récits de batailles, des fables, des prières, ou encore des plaintes d’amour toutes remplies à la fois de tristesse et de douceur. Il était alors si ignorant que le sens d’une foule de mots lui échappait, lorsque sa mère ou quelque ami lui récitait ces poèmes ; mais il n’en éprouvait pas moins, à les entendre, un bonheur singulier, comme si chaque vers eût évoqué devant ses yeux mille images vivantes, et fait chanter dans son cœur une volée d’oiseaux. L’harmonie, oui, c’était le nom qui convenait le mieux pour cette beauté, secrète, mais pourtant si belle ! Et Barsabas dut s’avouer que sa langue natale, tout au moins, était capable d’une telle harmonie.
Parmi les manuscrits de sa bibliothèque, il se rappela qu’il possédait un recueil de poésies populaires de la Galilée. Il l’avait fait venir à grands frais de Capernaüm, pour une série d’études qu’il projetait sur les déformations de la langue syrienne. Il courut le prendre, et se mit à lire les pièces qui, jadis, l’avaient le plus frappé. Mais en vain il essaya d’y retrouver leur ancienne beauté. La déformation de la langue syrienne y était décidément trop grossière et trop incorrecte : et puis quelle pauvreté d’idées, quelle absence de toute règle dans la prosodie ! Barsabas avait beau mépriser les poètes grecs et latins ; il voyait bien que leurs vers étaient cent fois supérieurs à ces informes complaintes. Celles-ci étaient désormais devenues plus muettes encore, pour lui, que l’Énéide et les deux Œdipe.